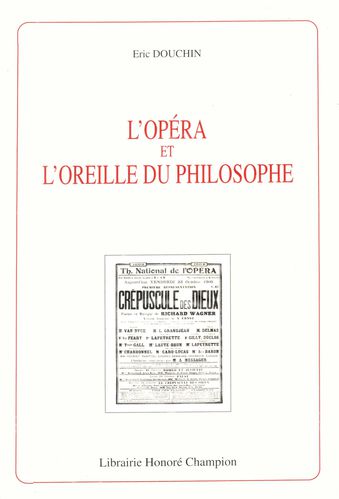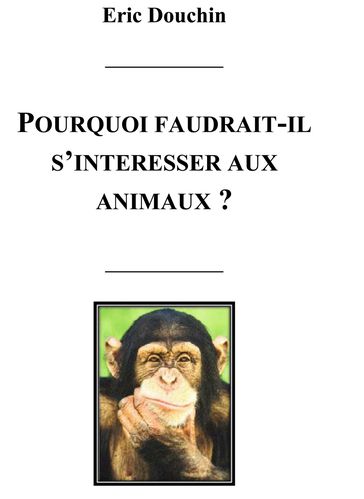
Pourquoi faudrait-il s'intéresser aux animaux ?
Les animaux sont à la mode ! Sauvages ou domestiques, étrangers ou familiers... Les documentaires animaliers se succèdent sur les écrans ; en ce moment les animaux marins semblent intéresser davantage le grand public plutôt que ceux de la jungle : manchots, orques et otaries disputent la vedette aux baleines. Le salon de l'agriculture attire les foules citadines qui se précipitent pour admirer au prix fort « veaux, vaches, cochons, couvée ».
Je cite ici Lafontaine pour souligner que cet intérêt pour les animaux ne date pas d'hier et qu'il ne concernait pas que le monde paysan : nobles et bourgeois se régalaient alors des fables et de leur bestiaire. Sous l'empire, Joséphine de Beauharnais avait installé à la Malmaison un véritable jardin d'acclimatation dont l'hôte le plus célèbre était une jeune femelle orang-outan arrivée en 1808. Plus tard, en 1826, sous Charles X, ce fut l'arrivée en France de la première girafe qui déplaça des centaines de milliers de personnes.
L'intérêt pour la faune sauvage ne s'est guère démenti depuis cette époque. En ce qui concerne les animaux familiers qui sont tout autre chose que de simples animaux domestiques, la fascination est aussi de mise et la relation sans doute encore plus complexe : il suffira d'en donner pour exemple celui des amis des chats comme Colette pour laquelle « à fréquenter les chats on ne risque que de s'enrichir », ou quelqu'un d'aussi sérieux que Montaigne qui écrivait : « quand je joue avec mon chat, qui sait s'il ne s'amuse pas plus de moi que je le fais de lui ? ». Mais il y a aussi les amis des chiens, des chevaux et on peut constater qu'aujourd'hui il est courant de rechercher des animaux familiers plus originaux : furets, rats quand ce ne sont pas araignées ou serpents. La possession de l'animal familier fait à l'évidence souvent partie des signes de la distinction.
La relation à l'animal et l'intérêt pour lui peut également se vivre sur le mode de l'agressivité : l'animal est la bête à tuer, à exterminer, à vaincre ou à soumettre : c'est souvent le culte du trophée.
Enfin, l'intérêt pour l'animal peut aussi être hanté par la peur : il devient alors une figure obsédante et terrifiante comme le loup des contes pour enfants.
L'intérêt pour l'animal est donc multiforme et relève souvent à l'évidence davantage du domaine de l'affectif que de celui du rationnel, et cet intérêt pour l'animal, au bout du compte, risque de nous en apprendre davantage sur l'homme que sur l'animal. Nous pouvons envisager le problème tout d'abord sous un premier angle, purement utilitariste : j'aime le poisson, l'agneau, le canard et plus encore, le homard ! Je les aime et je les mange avec gourmandise. Les théologiens diraient s'agit ici d'un amour de concupiscence et non d'un amour de charité : je les aime pour mon bien et non pas pour le leur. Après tout « l'homme ne vit pas seulement de pain », de fruits et de légumes, mais lorsqu'il en a la possibilité et n'est pas inhibé par des considérations religieuses, morales, esthétiques ou écologiques,. il mange de la viande Il s'agit là d'un intérêt tout naturel, inscrit dans notre réalité physiologique : l'animal est d'abord de la chair que notre organisme est adapté à digérer et à assimiler. Il serait illusoire de vouloir nier l'existence de cet intérêt primaire, mais bien réel pour l'animal : sa simple vue peut suffire à nous faire saliver. Il faut donc s'intéresser à l'animal et le premier à s'y intéresser est le cuisinier. La consommation de l'animal est source de plaisir et le but de la cuisine est de maximiser ce plaisir : quantitativement et qualitativement.
Quantitativement tout d'abord : il s'agit de rendre le maximum, voire la totalité, de la carcasse consommable et le premier moyen d'y parvenir est la cuisson qui se doit d'être fort longue pour certaines parties trop coriaces voire toxiques. La cuisson peut être réduite au minimum, voire inexistante dès lors que l'on considère que l'amélioration qualitative serait alors négligeable ; nous mangeons les huîtres crues : les Japonais, très exigeants sur l'absolue fraîcheur du poisson, le mangent cru, tout comme les Inuits mangent le phoque qu’ils viennent de tuer, encore tiède. Les amateurs de bœuf mangent le steak saignant ou tartare. Dans cette perspective, et paradoxalement à première vue, l'idéal de la cuisine est « le degré zéro » de la cuisine, c'est-à-dire l'aliment brut. Tout le travail se fait alors en amont : choix des produits : frais, tendres, etc.. Qu'il suffise de prendre pour exemple cet extrait de la recette du foie gras selon Paul Bocuse :
« L'acquisition d'un foie gras frais exige une certaine expérience ou tout au moins, un minimum d'informations.
Le marché offre, sans distinction, les foies d'oie et les foies de canard. Les premiers sont supérieurs aux seconds, surtout pour les préparations chaudes.
Certains foies de belle apparence deviennent gris à la cuisson, d'autres apparaissent veinés de filaments noirâtres, d'autres enfin fondent et se transforment en graisse liquide sous l'action de la chaleur.
Il faut savoir dépister ces défauts au moment de l'achat. Ce dépistage n'est d'ailleurs pas sans difficultés.
Pour cela, nous conseillons d'écarter les deux lobes et de vérifier l'intérieur. Refuser rigoureusement les foies qui n'ont pas une couleur rosée très franche et ceux striés de minuscules veines noirâtres. Pour en juger la qualité, prendre avec la pointe d'un couteau à l'intérieur de l'un des deux lobes gros comme un petit pois de foie. Rouler cette pâte doucement entre le pouce et l'index; la chaleur des doigts l'amollira, ou elle restera onctueuse et lisse, ou, devenant huileuse, elle se dissociera.
Acheter le foie de jolie couleur franchement rosée, sans veines et dont la chair, à l'épreuve ci-dessus, demeure lisse et onctueuse. »
Degré zéro de la cuisine, disions-nous : paradoxalement encore, l'idéal de la cuisson, lorsque la viande est tendre, est de la consommer à la température même de l'organisme vivant, c'est à dire aux environs de 37°, lorsque la viande est saignante mais n'est pas froide sans être cuite : j'en prendrai pour exemple la recette du bœuf en brioche :

![]()
Comme on le voit, après repos, découpe et service,, nous arrivons à une température proche de celle de la chair de l'animal encore vivant.
Ces considérations peuvent choquer, mais pourtant, la mode actuelle du « bio », alliée aux considérations écologistes, ne va-t-elle pas aussi souvent dans ce sens ? Le problème n'est pas de gaver des canards pour obtenir du foie gras, mais de les garantir sans OGM, à partir de produits du terroir. La dégénérescence stéatosique du foie du canard, gavé à en crever, (on le tue avant qu'il en crève), est parfaitement acceptable si c'est uniquement à base de maïs garanti sans OGM. Intérêt pour l'animal, certes, mais certainement pas dans son intérêt ! Quoi de plus normal : l'animal est utile, donc on le mange : alors que ce soit avec le minimum de pertes, au moindre coût et de la façon la plus agréable pour le consommateur. L'idéal de la bonne conscience est que l'animal n'apparaisse plus sous forme de cadavre reconnaissable, mais sous forme de matière mise en forme industriellement : steak haché, sticks de poissons, escalopes, saucisses, etc., et prête à consommer.
Cela peut conduire à un véritable déni de la réalité de la nourriture ingurgitée, rendue possible par la division sociale et économique du travail : je refuse de voir la réalité de ce que je mange, c'est-à-dire un cadavre qu'il a fallu tuer, dépouiller, étriper, découper et cuisinier.
Devenu méconnaissable, l'animal ressemble à un simple légume que l'on a de son côté pelé, haché, précuit, épicé, etc.…. Dans le hachis Parmentier qui reconnaît à coup sûr la viande, l'oignon et les pommes de terre ?
S'intéresser à l'animal, c'est, de façon très lointaine , en garder l'image comme forme abstraite et le réduire pratiquement a une matière non identifiable, informe et, si on accepte d'y mettre le prix, éventuellement succulente. L'exemple type est celui de la boîte de corned-beef où l'on voit sur une étiquette de la boîte la tête sympathique d'un bovin et à l'intérieur, une bouillie non identifiable mais certifiée comestible. Cette dissociation entre l’image et la réalité devient encore plus manifeste, allant jusqu’à l’absurdité, si l’on pense à un célèbre fromage à tartiner, sur la boite duquel on trouve la tête rouge d’une vache hilare. S’agit-il encore d’une représentation de l’animal ainsi colorié et métamorphosé par le rire qui est, comme Aristote l’avait en son temps rappelé, le propre de l’homme.
En fait, la réduction de l'animal à une simple ressource alimentaire se révèle d'autant plus facile qu'est rendu moins aisée son identification à un être vivant, plus ou moins identifiable à celui qui le consomme. L'huître est plus loin de nous que le singe. Pourtant cette différence poussée à l'extrême peut devenir telle qu'elle rend l'animal psychologiquement non assimilable : c'est la révulsion de beaucoup pour les huîtres ou les coquillages, celle, bien connue, de Jean-Paul Sartre pour les fruits de mer et les crustacés, crabes, homards et langoustes : « cette chair blanche, comme venue d'un autre monde. » C'est aussi l'aversion bien connue des occidentaux pour les vers, ou les insectes pourtant consommés dans d'autres civilisations : en Chine, n'appelle-t-on pas les sauterelles les crevettes des buissons ? Fera-t-on manger du singe, du chien ou du chat à un occidental ?
Cette réflexion sur la cuisine conduit à prendre conscience d'une double limite : on s'intéresse à l'animal comme objet de consommation à partir d'un minimum de prise de distance en deçà duquel, il est perçu comme trop proche pour être traité comme un simple aliment et jusqu'à un maximum de différence au-delà duquel il est perçu comme trop étranger pour être consommable.
Ces limites n'ont bien entendu strictement rien de naturel, mais elles sont entièrement définies à l'intérieur de la sphère de la culture et les différences culturelles en illustrent à l'envi la variabilité : les Indiens d'Amazonie se régalent de mygales grillées, les pygmées de termites qu'il serait difficile de faire avaler à des occidentaux, les Français d'escargots absolument répugnants chez leurs proches voisins. À l'inverse, déniant toute parenté ethnique et même biologique, certains peuples pratiquent dans des circonstances précises une anthropophagie qui suscite l'horreur et l'indignation ailleurs. Voltaire, dans l'article Anthropophage de son dictionnaire philosophique s'étonnait déjà de la sévérité de la condamnation de cette pratique.
L'homme est omnivore mais ne mange pas n'importe quoi et donc ne mange pas de n'importe quel animal : du lapin mais pas du rat, du lapin encore mais pas du chat, et dans les pays anglo-saxons, de toutes façons on ne mange pas de lapin. Ailleurs on mangera du phoque mais certainement pas du chien… On pourrait multiplier les exemples jusqu'à l'infini : une chose est certaine : ces distinctions n’ont strictement rien de rationnel et ne reposent sur aucune base biologique. Certains refusent de manger du porc, d'autres de la vache, mais pratiquement tout le monde mange de la chair dès qu'il en a la possibilité, quitte à s'en masquer la réalité par des artifices divers.
Les nutritionnistes ont beau nous expliquer, qu'écologiquement parlant, une nourriture végétarienne est beaucoup plus rationnelle qu'une nourriture carnée, il n'en reste pas moins que l’idée de la chair nous fait saliver et que les pays économiquement émergents voient augmenter immédiatement leur consommation de protéines d'origine animale : les Chinois mangent de moins en moins de riz et de plus en plus de viande.
Nous assistons donc à un phénomène dont la base est incontestablement physiologique, donc naturelle et universelle, mais dont les manifestations se font inévitablement à l'intérieur de structures culturelles donc extrêmement variables, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles soient rationnelles. Est-il si choquant de manger des cuisses de grenouille ?
Nous ne mangeons certes pas tous les animaux, mais beaucoup nous servent d'une autre manière en nous fournissant leur fourrure, leur cuir, leur graisse ou quelque autre élément de leur réalité corporelle ; la fourrure du vison est ainsi valorisée à l'extrême : que fait-t-on de sa viande ? Mange-t-on les huîtres perlières ? Là aussi on s'intéresse à l'animal, mais à l'évidence, le fondement de cet intérêt n'est plus simplement biologique : on peut vivre sans perles ! Et, si l'on a besoin de se protéger du froid, on n'a pas pour autant besoin d'un manteau de vison pour aller à l'opéra. Et pourtant… Proposons à une élégante une fausse fourrure, de fausses perles même semblables d'aspect : la réaction ne fera aucun doute. Le luxe a un prix, sinon ce ne serait plus le luxe, et une composante non négligeable de ce prix est la mort de l'animal : d'où, pour une grande part, l'intérêt pour les animaux d'élevage à la productivité supérieure quantitativement et qualitativement. Les éleveurs s'intéressent de près aux animaux et veillent à donner une nourriture équilibrée aux visons élevés en clapier et destinés à l'abattage : les éleveurs sibériens ont ainsi découvert que la viande de baleine ou de morse constituait une nourriture économique et profitable pour les animaux d'élevage.
On ne saurait toutefois se contenter d'envisager cela au simple niveau de l'utilité et de l'élégance. L'utilisation d'éléments du corps de l'animal tient aussi pour une large part à sa dimension symbolique : l'utilisation dans la pharmacopée orientale de la corne de rhinocéros ou du sexe de tigre séché ne tient à l'évidence pas à des qualités objectives mais à une valorisation symbolique du corps de l’animal.
L'animal n'est pas seulement un être naturel mais il se voit souvent prêter des propriétés surnaturelles. Historiquement, l'animal a souvent été considéré comme un totem, un dieu, un démon ou dénoncé comme une idole. Le totem est l'ancêtre mythique de la tribu et c'est à travers lui que l'individu se crée ou se découvre une identité. S'intéresser à l'animal, c'est s'intéresser à sa propre origine et le sacrifice rituel de l'animal totem, en recréant le lien social, permet à l'individu d'exister désormais en tant qu'homme qui va alors porter sur lui quelques fragments du corps de l'animal totem : dents de loup, plumes d'aigle par exemple. Sous une forme plus affadie, nous retrouvons ce sacrifice rituel dans des spectacles comme la corrida. Le taureau fascine et c’est toute une communauté qui se forme autour de l'arène et qui assiste au sacrifice de l'animal. D'un point de vue extérieur, cela peut surprendre et choquer : les adversaires de la corrida voient dans cette cérémonie le spectacle malsain des tortures infligées à un animal. On peut également de cette façon trouver ridicule l'octroi de ces trophées dérisoires que ce sont des oreilles ou une queue. Le taureau n'est pas un simple animal, c'est un symbole et tuer rituellement le taureau est vécu comme un acte fondateur. Le taureau n'est pas tué n'importe comment ni par n'importe qui : il est achevé, au terme d'une chorégraphie qui n'est pas autre chose qu'une danse rituelle aux figures imposées, par un sacrificateur aux gestes et au costume rigoureusement codifiés.
Les freudiens verront certainement dans cette immolation de l'animal-mâle par excellence la confirmation symbolique des thèses défendues par Freud dans Totem et tabous, et tout semble devoir inciter à cette lecture. Le taureau ne fut-il pas un des symboles divins principaux chez les anciennes civilisations de Mésopotamie et on sait que c'est sur cet arrière-plan que doit être comprise la destruction par Moïse du célèbre veau d'or, idole à travers laquelle risquait de se voir restaurer le culte des anciens dieux. Meurtre du père archaïque, aurait dit Freud, mais pourtant, le sacrifice de l'animal ne saurait se réduire à une symbolique si simple. Certes, Abraham sacrifie à Dieu, au lieu d'Isaac, un bélier aux cornes prises dans un buisson, mais il s'agit là encore d'un symbole mâle très explicite. Pourtant, par la suite, le sacrifice n'est plus celui d'un bélier ou d'un taureau mais celui d'un agneau lors de la Pâque, symbole essentiel également dans le christianisme et que nous retrouvons aussi, lié à la figure du sacrifice, dans l'islam lors du pèlerinage à la Mecque et lors de la fête de l'Aïd. La fonction alimentaire est ici subordonnée au devoir rituel et non l'inverse. Il est interdit de manger de la chair d'un animal qui n'aurait pas été sacrifié selon les rites et, a fortiori, d'un animal déclaré impur.
Cette frontière entre le pur et l'impur n'est pas, soulignons le, toujours une frontière entre l'animal et l'homme, mais elle traverse également le champ de l'humanité. Dans de nombreuses religions, l'homme ou la femme, parfois de naissance mais aussi souvent à certaines périodes, peuvent se retrouver impurs, l'animal étant à l'occasion parfois même plus pur que l'homme : mieux vaut être vache que paria pour les hindouistes par exemple.
Ce n'est pas pourtant ici notre propos et il faut en revenir à notre question initiale : pourquoi faudrait-il s'intéresser à l'animal ? C'est parce que le contact avec l'animal peut être révélation ou souillure et que cela met en jeu les relations de l'individu avec la divinité comme avec les autres hommes. Cette dimension du sacrifice est souvent implacable : celui qui n'a pas sacrifié l'animal selon les rites mais qui l'a cependant consommé peut devenir impur tout comme celui qui a touché l'animal impur.
D'un point de vue strictement rationnel que signifient ces notions de pur et d'impur si on les abstrait de toutes les considérations biologiques et physiologiques avec lesquels elles ne peuvent avoir de corrélations qu'accidentelles. Pourtant, même de façon inconsciente, ce sont peut-être souvent ces facteurs qui déterminent le goût ou l'aversion pour tel aliment, la phobie ou l'attirance pour tel animal.
En effet, notre intérêt pour l'animal n'est pas toujours amical ou intéressé : l'animal est aussi souvent le gibier à chasser ou l'ennemi qu'il faut absolument exterminer. Le but n'est pas alors fondamentalement de consommer, pas davantage de sacrifier au sens où nous l'avons vu, il est de tuer, de massacrer.
Parlons d'abord de la chasse car, s'il en est qui s'intéressent énormément aux animaux, ce sont les chasseurs. À première vue, la raison d'être première de la chasse est alimentaire ou utilitaire ; on s'aperçoit vite que la réduire à cela est absolument intenable : le chasseur ne mange pas toujours son gibier, loin s'en faut, souvent il le donne ou même l'abandonne. On chasse parfois même l'immangeable : pensons à la chasse au renard si prisée de l'aristocratie anglaise. Il n'est pas question de manger l'animal qui est alors déchiqueté par les chiens et on peut s'interroger sur l'utilité réelle de cette chasse. Plus fort encore, la façon même de chasser l'animal peut avoir pour conséquence de le rendre inconsommable ! C'est ici le cas de la chasse à courre : la chair de l'animal épuisé, pleine de toxines est devenue immangeable et la carcasse est abandonnée aux chiens ; une seule chose mérite éventuellement d'être gardée : le trophée. Mais souvent il n'y a même pas de trophée : le but est de faire un tableau de chasse, de faire un chiffre. On peut ici prendre pour exemple la belle nouvelle de Maupassant : la roche aux guillemots où il nous décrit la façon dont les chasseurs d'Etretat allaient en barque massacrer les guillemots perchés sur l'aiguille de Belval. Chacun connaît également Buffalo Bill et son célèbre duel contre Bill Comstock où il tua dans la journée 69 bisons contre 48 à son adversaire.
Cela peut choquer et sembler ridicule, mais cette forme d'intérêt pour l'animal ne saurait être passée sous silence : aujourd'hui, des chasseurs européens fortunés n'hésitent pas à payer fort cher pour un safari en Afrique ou ailleurs. Ce n'est certes pas pour manger le gibier, même parfaitement comestible : tout au plus ramènera-t-on quelques trophées.
L'animal le plus intéressant pour le chasseur, le plus prestigieux est le plus dangereux : le buffle, l'éléphant, mais surtout les fauves : ours blancs, lions, tigres, etc.. Au fond de tout chasseur, il y a un Tartarin, c'est-à-dire un tueur de lions. Tuer l'animal et surtout le fauve ferait de l'individu un homme ; et cela n'est pas propre à la civilisation occidentale : la chasse au lion, chez les Masaïs est un rite initiatique. Nous rejoignons ici en partie, notons-le, ce que nous avons souligné auparavant à propos du sacrifice de l'animal totémique. Mais il n'y a rien de tel dans les safaris d'aujourd'hui, pas plus qu'il n'y en avait dans les venationes organisées dans les amphithéâtres romains, (spectacle du matin), où l'on massacrait de nombreux animaux, quand on ne les faisait pas s'affronter entre eux, comme on le voit sur la frise en mosaïque de l'amphithéâtre de Zliten en Libye

.![]()
Scènes de massacres, certes, mais la relation était souvent inversée dans la damnatio ad bestias. L'animal intéresse ici dans la mesure où il est capable d'une violence meurtrière dont l'homme peut être victime, dévoré par les fauves par exemple.

![]()
Ces combats d'animaux existent encore aujourd'hui, même si c'est à une échelle moins spectaculaire : combats de chiens, combats de coqs par exemple. Le spectacle fascinant de la violence animale, nous le voyons également aujourd'hui dans les innombrables documentaires animaliers qui nous sont proposés : lions chassant, orques ou requins blancs dévorant des otaries, les exemples sont innombrables : nous avons des venationesen milieu naturel et sur grand écran ! Ceux-là même qui pensent avec horreur ou dégoût aux combats d'animaux qui régalaient les Romains, se délectent aujourd'hui de spectacles analogues sur leurs écrans ! L'animal peut être à la fois la bête à tuer et la bête qui tue.
Il n'est parfois que la bête à tuer qui peut fasciner jusqu'à l'obsession, parfois immonde : le rat, l'insecte, l'araignée. On s'intéresse alors à l'animal pour mieux le détruire et la recherche scientifique trouve souvent sa raison d'être dans ce projet. L'animal est alors un indésirable, un danger, un parasite, un rival et il devient vite un ennemi à exterminer.
Symétriquement, la curiosité scientifique pour l'animal peut conduire à son élimination : la constitution de collections de spécimens pour les muséums d'histoire naturelle a ainsi conduit à la disparition de certaines espèces d'insectes ou même d'oiseaux comme le grand pingouin. L'animal n'est plus un être vivant mais se réduit à un pur concept : le spécimen et à une momie conservée dans quelques muséums, référence pour le naturaliste, simple curiosité pour le visiteur. Qu'il soit vivant ou mort, peu importe : l'intérêt est ailleurs...
Il faut essayer de comprendre cet engouement pour les dinosaures qui a pris une dimension planétaire depuis quelques années. Qu'avons-nous à faire des dinosaures ? Ils ne sont plus ! Les hommes n'ont jamais eu affaire à eux. Ils ne font même pas partie de notre histoire ! Que quelques paléontologues les étudient, soit, peut-être une vaine curiosité de scientifiques en mal d'objets d'étude, pourquoi pas ? Mais comment expliquer le succès mondial de films comme Jurassic Park et ses multiples déclinaisons ou le succès commercial de ces dinosaures, jouets, animations mécaniques ou moulages en matière plastique ? Et même aujourd'hui, osons poser la question : comment peut-être entomologiste ? Comment peut-on s'intéresser à ces bestioles bizarres, à cette inquiétante étrangeté ? Qui plus est, il faudrait se soucier de la survie de telle ou telle espèce de coléoptères et en assurer, le cas échéant, à grand prix la préservation ! À quoi bon ? Depuis des millions d'années les espèces apparaissent et disparaissent : c'est le prix de l'évolution. On parle beaucoup de diversité biologique : il n'est pas certain, par exemple, que la préservation ou la réintroduction volontaire ou non du loup dans certains biotopes soit si favorable au maintien de la diversité biologique et, accessoirement, (si l'on peut dire !), à la prise en considération des intérêts humains...
Qui prendra la défense, si cela s'avère nécessaire, du doryphore ou de la pyrale du maïs ? Existe-t-il une association pour défendre les rats ?
Pourtant, même nuisible aux intérêts humains, totalement étranger ou insignifiant, l'animal fascine : de l'acarien microscopique jusqu'à la baleine bleue de 190 tonnes! À la fois semblable et différent, terrifiant ou attendrissant, admirable ou répugnant, l'animal suscite d'abord chez l'individu une réaction affective variable d'un individu à l'autre et, plus encore, d'une civilisation à l'autre. La relation à l'animal est affective avant d'être rationnelle et, sur ce point, il peut être utile de se souvenir de l'analyse que Jean-Jacques Rousseau a pu faire de la pitié dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes : la pitié, nous dit-il, est fonction du degré d'identification à celui qui souffre et fonction inverse du degré de réflexion : on peut avoir davantage pitié de son chien que d'un étranger, et réfléchir trop souvent avant de venir en aide à celui qui est en danger conduit bien souvent à un abandon de l'initiative altruiste.
En ce qui concerne l'animal, comment peut-on s'identifier à l'animal, ce qui différencierait l'intérêt porté à l'animal de celui porté à une plante ou même à un objet quelconque ?
Le premier critère que l'on pourrait évoquer serait celui de la ressemblance : l'araignée que l'on écrase semble beaucoup plus étrangère que le mammifère ou le primate aux expressions parfois si humaines ? Mais cette ressemblance n'est-elle pas un critère irrationnel ? La grenouille nous ressemble davantage, morphologiquement, qu'une vache ou un rat ; et pourtant, nous mangeons des cuisses de grenouille et, dans nombre de pays, la population ne rechigne guère à consommer de la chair de primates pourtant si proches de nous. L'argument ultime, ici, serait la pratique de l'anthropophagie où l'homme n'hésite pas à manger son semblable, même si cela se produit dans le cadre de rites funéraires, magiques ou religieux.
Si la ressemblance ne suffit pas à créer ce lien affectif, il en va tout autrement de l'imprégnation : les spécialistes de l'éthologie ont décrit à l'envi ce phénomène qui conduit de jeunes animaux à se comporter à l'égard de représentants d'autres espèces comme à l'égard de leurs parents biologiques. Certes, de tels comportements ne sont qu'exceptionnels chez l'homme, ne serait-ce que par ce qu'il reste heureusement rarissime qu'un jeune humain soit élevé par des animaux. Pourtant la proximité entre l'animal et l'homme, notamment du fait de la quasi omniprésence de l'animal familier, dont le statut est bien différent de celui de l'animal simplement domestique, ne saurait que faciliter ce phénomène.
Il convient ici de s'arrêter sur ce que les psychologues appellent l'objet transitionnel : souvent le nounours, la poupée, le doudou, etc.. L'objet transitionnel n'est pas simplement une chose ! La charge affective qu'il se voit attribuer conduit à le considérer comme une quasi personne dont il hérite du caractère sacré ; c'est le plus souvent une image animale qui se voit attribuer ce rôle d'objet transitionnel dont la première caractéristique est d'être muette. L'animal, lui non plus ne parle pas et n'exprime guère, comme le soulignait déjà Descartes dans sa lettre au marquis de Newcastle, que des passions, c'est-à-dire des modifications de son état corporel, sans jamais pouvoir répondre aux questions qu'on lui pose. On lui prête pourtant pensée et sentiments mais sans jamais être assuré de la validité objective d'une telle attribution. Le silence des nounours autorise toutes les projections affectives et les quelques grognements des ours ne sauraient tenir lieu de dénégations. Les ours en peluche ne sont pas des imitations de koalas ; il se trouve par hasard que les koalas végétariens ressemblent à des ours en peluche ! Les vrais ours ne sont pas si aimables, et l'homme s'est consciencieusement appliqué jusqu'à nos jours à les exterminer.
Bien loin de constituer l'archétype de la relation de l'homme à l'animal, la relation à l'animal familier apparaît comme le résultat d'une élaboration complexe où s'abolit presque entièrement la distance entre l'homme et l'animal. L'animal domestique, doit-on le côtoyer tous les jours, ne devient pas nécessairement pour autant un animal familier et l'on n'hésitera pas à l'exploiter, à le vendre ou à le consommer. Il en va tout autrement pour l'animal familier : qui envisagerait sereinement de manger son chien ?
L'animal parvient souvent à être traité pratiquement comme un membre de la famille : et on arrive pratiquement à lui reconnaître les mêmes droits dans la déclaration des droits de l'animal.
L'animal est l'autre, et, s'il n'est pas pleinement autrui, il en possède certaines des caractéristiques essentielles. Husserl distinguait, dans les Méditations cartésiennes, trois niveaux de la découverte d'autrui : le corps, le moi psycho physique et l'ego transcendantal. L'animal est d'abord un corps et Descartes ou Malebranche voulaient le réduire à n'être que cela : de la force, de la graisse, du cuir et de la viande pour schématiser à l'extrême ! Et l'homme, à la base, relève de la même réalité : il est d'abord corps et, en tant que tel, susceptible d'être utilisé, voire consommé, objet de désir ou de dégoût.
Pourtant, l'animal, pas plus que l'homme, ne saurait se réduire à sa réalité biologique : c'est aussi, au moins pour les animaux supérieurs, un moi psycho physique, c'est-à-dire un être sensible susceptible d'éprouver du plaisir de la douleur. Nous précisons pour les animaux supérieurs : car plaisir ou douleur présupposent l'existence d'un système nerveux central suffisamment complexe pour permettre l'apparition de ces émotions primaires. On sait que, même chez l'être humain, le non fonctionnement de certaines zones du cerveau, anomalie parfois innée, rend l'individu totalement insensible à la douleur. Est-il si simple de faire la part des choses ? Bien souvent, nous sommes conduits à projeter sur l'autre et donc sur l'animal l'image de notre propre sensibilité. Il s'agit là d'un comportement préalable à toute socialisation : comment et pourquoi reconnaître des droits à celui qui ne serait capable ni de bonheur et de souffrance ? Il ne serait guère différent du végétal que l'on taille, moissonne et consomme sans états d'âme. C'est ainsi que nous mangeons les huîtres, les moules ou les oursins dont l'extrême éloignement morphologique nous préserve en grande partie de toute identification perturbatrice. Il n'en est pas de même pour les animaux supérieurs qui nous ressemblent parfois beaucoup plus et dont le mouvement où les cris nous interdisent d'oublier la douleur ou le plaisir. Mais l'animal ne parle pas ; et interpréter mouvements ou vocalisations laisse encore la place à toutes les projections anthropomorphiques.
Il reste un troisième niveau de la rencontre de l'autre, celui de l'ego transcendantal, de l'être pensant et raisonnable, capable de pensée et de langage et c'est à ce dernier niveau que la reconnaissance de l'animal devient la plus problématique. Jérémy Bentham soulignait qu'un chien ou un cheval sont certainement capables d'opérations mentales plus complexes qu'un nourrisson humain ; et, aujourd'hui, avec le progrès des connaissances en éthologie, que dirait-on des performances des chimpanzés, bonobos ou des cétacés ? Et pourtant, « on » continue à chasser les cétacés pour leur viande et leur graisse, et le commerce des primates, quand ce n'est pas le commerce de leurs organes ou la consommation de leur chair est encore bien réel.
L'infériorité intellectuelle de l'animal a souvent conduit à le traiter comme une simple chose et à lui dénier toute sensibilité ; Jeremy Bentham, là encore, avait su, il y a de cela deux siècles, poser parfaitement le problème : « Un jour viendra peut-être où le reste de la création animale pourra acquérir ces droits que seule la main de la tyrannie lui a déniés. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est pas une raison d’abandonner sans recours un être humain au bon plaisir d'un bourreau. Il n'est pas exclu qu'on reconnaisse un jour que le nombre de pattes, la villosité de la peau ou la terminaison de l'os sacrum sont des raisons tout aussi peu adéquates d'abandonner un être capable de sentir au même sort. Quoi d'autre pourrait déterminer la ligne infranchissable ? La faculté de tenir des discours ? Mais un cheval ou un chien adulte est, sans comparaison, un être plus rationnel et qui a plus de conversation qu'un nourrisson d'un jour, d'une semaine, ou même d'un mois. À supposer toutefois qu'il en soit autrement, qu'est-ce que cela changerait ? La question n'est pas : peuvent-ils raisonner, ni : peuvent-ils parler, mais : peuvent-ils souffrir ?” An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,p. 283.
Et c'est là, je crois, la première raison pour laquelle il faut s'intéresser aux animaux : non pas simplement à des fins intéressées exploiteuses ou consommatrices, pas davantage du fait de la projection irrationnelle de pensées et de sentiments humains sur des organismes parfois très differents, mais simplement du fait qu’il s'agit bien souvent d'êtres sensibles tout comme nous, quoique à des degrés divers, et que cette question nous renvoie à notre responsabilité morale et non pas seulement écologique qui pourrait, si l'on en reste là, s'avérer extrêmement dangereuse : l'homme n'est-il pas un super prédateur qui a tout intérêt à la préservation de ses ressources ? Mais l'animal est tout autre chose qu'une simple ressource !
Eric Douchin
_________________________