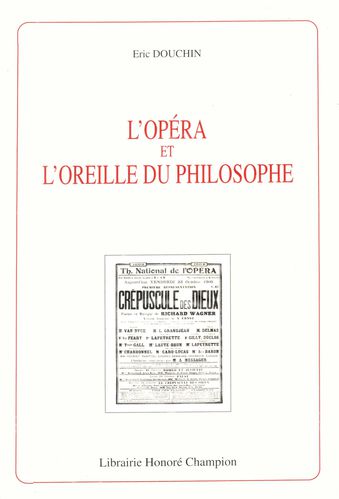4éme journée Ecole-Hôpital
Mercredi 6 mai 2009
Cadres et limites.
Institut de formation en soins infirmiers 26, rue Foubert 76600 Le Havre
Eric Douchin
L'obéissance entre soumission et autonomie
J’aimerais commencer cet exposé et du même coup la journée de réflexion qui nous est proposée par ce passage d'un texte de Bernard Defrance daté du 30 octobre 2004 ; professeur de philosophie au lycée Maurice Utrillo de Stains (93), il est notamment l'auteur de « Sanctions et discipline à l'école » La découverte - cinquième édition -2005 et « Le droit dans l'école » Labord 2000.
Il existe « une confusion tragique entre l'exercice du pouvoir du professeur sur la classe avec l'exercice de son autorité dans la classe qui entraîne symétriquement chez les élèves la perversion de l'obéissance en soumission. Inutile d'être psychanalyste pour savoir ce que signifie, pour un être humain appelé à la liberté, le fait de devoir se soumettre, c'est-à-dire « se mettre dessous »... Se soumettre c'est s'abaisser, ce qui est en contradiction complète avec l'exigence de s'élever à laquelle doivent apprendre à obéir les élèves ! Que des individus apparemment instruits, aux plus hauts niveaux des responsabilités politiques, se révèlent incapables de comprendre la contradiction fondamentale entre pouvoir et autorité, entre obéissance et soumission, révèle l'état de complète déliquescence dans lequel certains font sombrer actuellement le débat sur l'école. Celui qui exige la soumission renonce à obtenir l'obéissance, celui qui impose son pouvoir renonce à toute autorité - et dès que « le chat n'est pas là », n'est-ce pas... »
Oui, lorsque le chat n'est pas là que devient son pouvoir de coercition, de représailles et que reste-t-il dès lors de son autorité ? Les ordres qu'il a pu donner, les interdits qu'il a pu formuler, pourquoi donc s'y plier encore ? Sans Dieu, sans fouet, sans bâton, sans prisons, sans enfer, « rien est vrai, tout est permis ». Privons un enseignant du pouvoir de coller, de sanctionner, d'exclure, de convoquer les parents, ne le privons-nous pas du même coup de son autorité ?
Advient alors souvent ce paradoxe : ce n'est plus l'élève qui tremble mais l'enseignant hésitant à l'idée de tourner un moment le dos à sa classe pour écrire quelque chose au tableau ! Il faudrait alors un surveillant ou, à défaut, une caméra de vidéosurveillance scrutant à chaque instant les élèves et permettant d'identifier tricheurs, bavards, perturbateurs et autres « fortes têtes » qu’il sera alors possible de sanctionner de façon quasi automatique selon une échelle de sanctions préalablement définies, si possible de façon collégiale et validée selon les procédures administratives en vigueur afin d'éviter toute contestation par des parents de mauvaise foi, des élèves vicieux et des associations aux arrières pensées plus ou moins subversives.
Rien ne va plus ! Savez-vous pourquoi ? On ne fait plus de latin à partir de la sixième ! Et, pire encore, on voit des enseignants, horreur ultime : des ministres - on n'ose pas dire des premiers ministres et, tant qu'à faire, pourquoi pas des présidents ! - qui n'en ont pas la moindre notion. Il s'agit pourtant de former des maîtres : I. U. F. M. et l'on sait aujourd'hui le débat passionné autour de la défense ou de la dissolution de ces instituts.
Ne désespérons pas, pourtant, rien n'est perdu et quelques prénotions de latin accessibles même à ceux qui n'ont pas eu l'honneur de pratiquer les humanités peuvent commencer à éclaircir quelque peu les idées.
Il faut former des maîtres et depuis bien longtemps on appelle l'instituteur le maître d'école et non pas, notons-le, le maître des enfants ni même le maître des élèves. Il est vrai qu'à l'époque on entendait clairement ce que signifiait le substantif maître : « magister » en latin, que nul n'aurait confondu avec un autre maître : « dominus », le seigneur. Le maître d'école n'a jamais été le seigneur du village et a-t-on jamais vu quelque hobereau se faire instituteur ? Même lorsque l'instituteur était le curé du village, le pouvoir religieux est resté distinct de l'autorité professorale et l'idéal de laïcité clairement conceptualisé à partir de la fin du 19è siècle affirme de façon parfaitement explicite la distinction entre les deux ordres. L'autorité de l'enseignant demeure alors que le pouvoir du tyranneau de village a depuis longtemps disparu : on continue à respecter et à appliquer les règles de la syntaxe, de l'orthographe et, bien au-delà, les lois de la société à l'intérieur de laquelle on est amené à vivre, les principes de la morale qui ont été inculqués depuis l'enfance, parfois répétés par le curé, d'autres fois par l'instituteur républicain - pas si différentes, à y regarder de près !...
À quoi servirait un enseignement dont on jetterait les cahiers au feu, sitôt passé le dernier examen ? À quoi serviraient des parents dont, dès la majorité, les enfants rejetteraient les principes d'éducation ? « J’ai 18 ans, Papa et Maman n’ont plus le droit de me punir ni de m'interdire quoi que ce soit ! » Plus de pouvoir, donc plus d'autorité et s'il n'est plus nécessaire de se soumettre à quoi bon obéir ?
On commence à percevoir l'importance des différences et pourtant partout règne la confusion : que l'on cherche dans un dictionnaire la définition de la soumission et apparaîtra plus ou moins vite dans la définition le terme d'obéissance, et que l'on cherche celle d'obéissance on y rencontrera toujours celle de soumission.
Il serait futile et insoutenable de remettre en cause la compétence des lettrés érudits qui rédigent ces dictionnaires. Un dictionnaire ne fait que rendre compte de l'usage des différents mots dans une société donnée, à une époque historique donnée et d'en donner éventuellement des exemples. Tout ceci est légitime mais reste à la porte de l'interrogation philosophique qui vise en partant des mots à construire des concepts.
Soumettre : Bernard Defrance le souligne avec justesse, signifie d'abord mettre dessous, se soumettre : se mettre dessous. Il n'est pas besoin de penser pour se soumettre, ni même d'être humain pour adopter une attitude de soumission : le chien qui rampe, la queue entre les jambes, urine sous lui, se met sur le dos pour offrir son abdomen sans défense au dominant, se soumet à ce dominant. L'idée de soumission est indissociable de celle de hiérarchie avant même de l'être de celle de pouvoir.
En effet, dans les sociétés animales on constate souvent des rapports de hiérarchie qui ne sont d'ailleurs pas toujours des rapports de force, alors que l'on n'observe jamais de rapports de pouvoir.
La hiérarchie dans une société animale peut-être fondée sur le sexe, sur l'âge, sur des critères d'aspect physique sans que ce soient nécessairement des rapports de force : par exemple chez les éléphants d'Afrique c'est la plupart du temps une vieille femelle qui dirige le troupeau.
Un rapport de pouvoir permet la délégation d'une tâche par l'intermédiaire d'un ordre : le lion n'ordonne pas aux lionnes d'aller lui abattre un zèbre... On ne se méfie jamais assez des illusions anthropomorphiques : la reine des abeilles n'a aucun pouvoir, pas davantage le lion dominant.
Les rapports de pouvoir n'apparaissent que dans l'ordre humain : soit dans les relations entre l'homme et l'animal, par exemple entre le chasseur et son chien, soit dans les relations d'homme à homme.
Ces rapports de pouvoir sont multiformes sans être d'ailleurs toujours hiérarchiques : on parle ainsi de pouvoir parental, administratif, religieux, politique, économique, etc. Ces rapports de pouvoir peuvent être librement choisis, mais ils sont le plus souvent imposés, que ce soit par la force des choses (pouvoir parental par exemple) ou par la volonté humaine (individuelle ou collective). Le pouvoir permet d'éviter le recours à la violence, c'est-à-dire à la contrainte physique : si je donne un ordre et que cet ordre est exécuté, il ne m'est pas nécessaire de recourir à une contrainte physique. Celle-ci ne devient nécessaire que lorsque le rapport de pouvoir ne fonctionne plus : on maîtrise le forcené, on emprisonne, parfois même on élimine le récalcitrant. L'usage de la violence est la conséquence d'un échec du pouvoir : lorsque le pouvoir exécutif ou législatif ne fonctionne plus, on fait appel à la police ou à la force armée. Ceci ne doit cependant pas cacher que bien souvent l'origine du pouvoir est à chercher dans un rapport de forces : c'est ce que Pascal rappelait dans Les Pensées : « La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers et de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur fait que leur visage, quand il est quelquefois seul et sans ses accompagnements imprime dans leurs sujets le respect et la terreur parce qu'on ne sépare point dans la pensée leurs personnes d'avec leurs suites qu'on y voit d'ordinaire jointes. Et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force naturelle. Et de là viennent ces mots : le caractère de la divinité est empreint sur son visage, etc. ». Pensées 25-308 – p.503.
Quand il y a rapport de pouvoir la violence n'est parfois que rarement utilisée mais la force est là en arrière-plan, prête à servir et c'est donc elle en dernière analyse qui provoque la soumission. Cette dernière n'est donc en aucun cas une vertu car elle repose sur la crainte et la soumission ne dure qu'aussi longtemps qu'existe le rapport de forces ; l'esclave n'obéit pas au maître : il fait simplement acte de soumission. Le maître n'a nul besoin d'autorité, il lui suffit d'avoir un fouet. La soumission au pouvoir est donc fondamentalement hétéronomie : le sujet se plie à la volonté, à la loi d'un autre : le maître, dominus, le dominant.
Il peut donc exister des formes de pouvoir, même tyranniques, sans qu'existe de fait la moindre autorité : la crainte suffit pour entraîner la soumission. Celui qui détient le pouvoir n'est même pas nécessairement celui qui possède la force et qui est seul à pouvoir exercer la violence. C'est le principe du chantage : le maître chanteur, en menaçant de dénoncer sa victime à ceux en mesure de procéder à des mesures de rétorsion, tente ainsi d'obtenir la soumission de celui qu'il cherche à manipuler. L'enseignant peut ainsi tenter d'exercer un chantage sur les élèves en les menaçant de les envoyer chez le proviseur, de convoquer leurs parents par exemple ; mais à l'inverse ce peut-être aussi l'élève qui peut tenter d'obtenir la soumission de l'enseignant en le menaçant de quelque dénonciation plus ou moins calomnieuse auprès de l'administration, de la police, de la justice, etc.
On s'aperçoit ainsi de ce que les véritables rapports de pouvoir sont infiniment plus complexes qu'on pourrait le croire à première vue et que vouloir obtenir la soumission de l'autre peut se révéler très vite un jeu dangereux ou le présumé dominant n'est nullement certain de l'emporter. Il peut suffire de le compromettre pour le réduire à merci. Que l'on se souvienne du personnage du professeur dans ce classique du cinéma qu'est l'Ange bleu pour citer un exemple parmi tant d'autres.
Est-il alors légitime de réduire les relations de pouvoir à un simple rapport de domination et de soumission ? Dans ce cas, l'essence même du pouvoir serait la tyrannie et ses deux points d'appui ne seraient autres, comme l'a bien montré Machiavel, que la violence et le mensonge :
- violence (que ce soit son exercice, son souvenir ou sa menace) pour se faire craindre, le mensonge pour ne pas se faire haïr. En effet, soulignait le politique florentin, la haine peut être plus forte que la crainte, même que la crainte de la mort. Quelle soumission peut-on dès lors espérer de celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour abattre l'oppresseur ? C'est une impasse dans laquelle se fourvoient le plus souvent les forces militaires d'occupation confrontées à des insoumis vite qualifiés, à tort ou à raison, de terroristes qu'il ne reste plus qu'à tenter d'éliminer.
Bien évidemment, dans un établissement scolaire on ne recourt pas à des mesures aussi radicales : l'élimination se réduit à une simple exclusion de l'établissement, en d'autres termes, à un exil. Certaine candidate à des élections importantes a également proposé de confier à l'armée le soin de remettre au pas les élèves trop fortes têtes qu’il serait trop dangereux de laisser livrés à eux-mêmes et prêts à déstabiliser l'ordre social.
- Mensonge alors ? cela peut se pratiquer de multiples façons : Machiavel, encore lui, dans Le Prince évoque le jeu des promesses. Celles-ci peuvent permettre au moins pour un temps d'éviter la révolte à défaut d'obtenir la résignation. Mais ce peut être aussi la dissimulation : le prince, sous un masque de dévotion, de bonhomie, de justice, exerce sur ses sujets un pouvoir tyrannique dont ils croient d'autres responsables. Ces pratiques, là encore, ne sont pas absentes du domaine pédagogique : l'enseignant peut être lui aussi un comédien démagogue et manipulateur de ses élèves.
Et pourtant, la soumission qui résulte de la crainte reste non seulement avilissante mais est également intrinsèquement perverse comme le rappelait Spinoza : « Aussi longtemps en effet que les hommes agissent seulement par crainte, ils font ce qui est le plus contre leur volonté, et ne considèrent aucunement l'utilité et la nécessité de l'action, mais n'ont souci que de sauver leur tête et de ne pas s'exposer à subir un supplice. Bien plus, il leur est impossible de ne pas prendre plaisir au mal et au dommage du maître qui a pouvoir sur eux, fût-ce à leur grand détriment, de ne pas lui souhaiter du mal et lui en faire quand ils peuvent. Il n'est rien en outre que les hommes puissent moins souffrir qu'être asservis à leurs semblables et régis par eux. » Traité théologico-politique, 1670, Chapitre V, trad. C. Appuhn, GF, pp. 106-107.
Pourra-t-on dire qu'il possède une autorité celui dont les subordonnés complotent la perte ? Et peut-on qualifier d'obéissance la soumission hypocrite aux puissants ? C'est donc ailleurs qu'il convient de chercher les fondements de l'obéissance et de l'autorité.
Peut-on parler, comme on l'entend souvent, d'une autorité naturelle qui entraînerait une obéissance spontanée ? C'est bien souvent une illusion que dénonçait déjà Pascal dans ce passage des pensées que je citais plus haut : faiblesse et folie des hommes seraient alors les meilleurs garants du pouvoir. Nous retombons encore dans ce rapport domination/soumission évoqué tout à l'heure.
On trouve cependant chez Pascal une autre piste où il oppose l'obéissance du soldat et l'obéissance du chartreux : « Quelle différence entre un soldat et un chartreux quant à l'obéissance ? Car ils sont également obéissants et dépendants, et dans des exercices également pénibles, mais le soldat espère toujours devenir maître et ne le devient jamais, car les capitaines et princes mêmes sont toujours esclaves et dépendants, mais il l'espère toujours, et travaille toujours à y venir, au lieu que le Chartreux fait vœu de n'être jamais que dépendant. Ainsi ils ne diffèrent pas dans la servitude perpétuelle, que tous deux ont toujours, mais dans l'espérance que l'un a toujours et l'autre jamais. » Les Pensées -356-539 p.544.
Le soldat obéit par espoir de devenir officier, par ambition : on est encore ici dans le domaine des promesses illusoires. Que ses espoirs soient déçus, il se retournera contre son maître : pensons à l'exemple d’Iago dans l'Othello de Shakespeare. Il en va tout autrement du Chartreux : pourquoi donc obéit-il ? Cela ne saurait que superficiellement s'expliquer par l'espérance d'une récompense future, auquel cas son obéissance ne serait guère différente de celle de l'officier qui espère une promotion et ne mériterait en aucune façon d'être qualifiée de vertu. On se doute bien que la pensée de Pascal est plus subtile et il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que le fondement de l'obéissance du Chartreux n'est pas l'espérance mais tout simplement la foi.
Nous voici bien loin, semble-t-il, de notre salle de classe avec une telle expérience mystique ! Ce n'est pourtant qu'une apparence : prenons la peine de nous interroger sur ce que signifie ce terme de foi : repensons à notre latin : foi se dit fides, c'est-à-dire confiance ; la foi est confiance et la véritable obéissance n'est pas basée sur la crainte ou l'espérance mais est basée sur la confiance. Le magister en lequel on a confiance n'a nul besoin d'être dominus et le dominus en lequel on n'a pas confiance ne sera jamais magister, quelle que soit la crainte qu'il inspire ou quelles que soient les promesses qu'il puisse faire.
Du coup, on aperçoit plus clairement la distinction entre autorité et pouvoir : l'autorité n'a d'autre fondement que la confiance, quand le pouvoir ne tire sa puissance que de sa force réelle ou supposée. À la guerre, le chef qui a perdu la confiance de ses soldats n'a plus aucune autorité et il ne lui reste que la menace ou la violence pour contraindre ses subalternes à obtempérer à ses ordres. Que l'on ne s'y trompe pas, ils n'obéissent pas alors, ils se soumettent, provisoirement le plus souvent, prêts à se révolter à la première occasion ; les soldats aujourd'hui si disciplinés seront demain les premiers mutins. Le capitaine de vaisseau si redouté finira demain pendu au bout d'une vergue.
On n'obéit qu'à une autorité et c'est la confiance qui crée l'autorité : ce qui veut dire que l'autorité se mérite et qu'elle présuppose le jugement libre et éclairé de celui qui se déclare prêt à obéir ou, tout au moins, la nuance est d'importance, elle présuppose son consentement. Revenons à notre Chartreux : il a fait vœu d'obéissance et c'est avec son consentement qu'il lui est interdit de sortir, de parler avec les autres moines, de s'écarter tant soit peu de la règle : son obéissance n'est que l'expression d'un consentement ; en d'autres termes, en obéissant il ne fait pas autre chose que ce qu'il a décidé : la règle à laquelle il se plie est celle qu'il a choisie, c'est donc l'expression de sa volonté : son obéissance est la manifestation de son autonomie. Bien loin de la soumission, l'obéissance apparaît dans cette perspective comme un acte de liberté.
Que l'on ne voie pas là une vision de l'obéissance strictement déterminée par la foi chrétienne : la conception du monde que proposait l'antique stoïcisme n'était pas si différente. Pascal d'ailleurs ne s'y était pas trompé et ce n'est pas un hasard s'il tenait tant à se démarquer Épictète et des stoïciens qui n'avaient foi qu'en la raison et au destin.
Si l'obéissance se fonde en dernière analyse sur une autonomie, la même autonomie ne justifie-t-elle pas du même coup un droit à la désobéissance et celui qui obéit lorsqu'il décide d'obéir est-il encore obéissant ? Si nous revenons à notre Chartreux, son vœu d'obéissance n'est-il pas un engagement de ne jamais désobéir, c'est-à-dire en dernière analyse une soumission inconditionnelle ? Cela est-il possible sans l'ombre de la moindre menace, sans l'idée de la moindre espérance ? À la fin du XVIIIe siècle, Kant écrivait qu'il fallait faire son devoir simplement par devoir en obéissant à la voix intérieure de la raison : « Agis de telle manière que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle ». Ne discutons pas pour l’instant ce principe : c'est donc à sa conscience qu'il faudra obéir et non pas à César ; les problèmes casuistiques apparaissent alors très vite et ils ne sont pas toujours superficiels. César exige d'être obéi et il ne se contente pas de « ce qui revient à César » : il exige une obéissance inconditionnelle et toute réticence, toute restriction sera comprise comme trahison.
Alors ne reste-t-il plus ce que ce choix : se soumettre à César ou encourir les risques de l'insoumission ? C'est là le premier problème de l'obéissance : exiger l'obéissance est une impossible gageure s'il s'agit d'exiger la confiance ! En fait, la seule chose qu'il soit (parfois) possible d'exiger, c'est la soumission et nous avons déjà vu les difficultés que cela entraîne.
Ce n'est pas pourtant la seule difficulté à laquelle on se heurte dès l'instant où l'on essaie d'approfondir ce concept d'obéissance : on obéit, avons-nous vu, à une autorité, laquelle repose sur une relation de confiance. Mais cette confiance est bien souvent accordée spontanément, sans aucune démarche critique et on a alors affaire à une obéissance aveugle capable des pires errements.
L'enfant obéit à ses parents, non pas par ce qu'ils exercent sur lui un pouvoir, (même si ce pouvoir existe effectivement dans la plupart des cas - il n'est pas question de le discuter) mais parce qu'il leur fait tout naturellement confiance. Le patient obéit aux prescriptions parfois désagréables de son médecin parce qu’il lui fait confiance ; la confiance disparaît-elle, on arrête le régime, on jette les médicaments à la poubelle et on change de médecin. Les parents, le médecin sont reconnus par la plus grande partie de la population qui leur fait confiance comme des autorités ; les enseignants souffrent souvent, on ne le sait bien, de ce manque de reconnaissance qui leur rend bien souvent impossible l'exercice de leur fonction.
Mais, même lorsque « tout se passe bien », les pires perversions de l'obéissance restent à craindre : il suffit de penser ici aux célèbres expériences de Milgram maintes fois reproduites avec toujours les mêmes résultats : des cobayes, recrutés sans le savoir comme pseudo collaborateurs scientifiques par une autorité universitaire reconnue, obéissent avec zèle à des consignes d'expérimentation susceptibles d'infliger de graves souffrances, voire des lésions irréversibles aux sujets testés.
On a pu remarquer lors de ces expériences, que, lorsque le directeur d'expérimentation était physiquement présent, le taux d'obéissance était supérieur de près de 30 % à celui observé lorsqu'il était physiquement absent. De même le taux d'obéissance était très supérieur lorsque l'expérience avait eu lieu dans le cadre des locaux de l'université à ce qu'il était lorsque l'expérience avait eu lieu dans des locaux non marqués institutionnellement.
Si l'on essaie de tirer la leçon de ces expériences à la lumière des remarques précédentes, il s'ensuit que l'autorité et la relation de confiance qui la rend possible n'est pas tant le résultat d'une relation interpersonnelle que celui de l'intégration à une institution (et la famille est elle-même une institution), susceptible de donner à l'individu, identité, pouvoir et autorité.
La seule réponse d'Eichmann à son procès, lorsqu’on le questionnait sur la justification de ses agissements criminels était : « J'ai obéi aux ordres ». L'obéissance peut être la justification sinistre des crimes les plus abominables. Le bourreau qui allait brûler tout vivants quelques malheureux supposés hérétiques, relapses ou sorciers, lui aussi obéissait à des ordres et faisait confiance à l'autorité de l'institution qui condamnait la victime au bûcher.
L'obéissance est loin d'être toujours une vertu et, lorsque l'autorité à laquelle elle se plie est criminelle, cette même obéissance devient complicité parfois passive mais aussi souvent active.
Comment alors expliquer de telles perversions de l'obéissance dès lors qu'il ne s'agit plus d'exceptions individuelles mais de comportements collectifs, parfois même de comportements de masse. La Shoah n'a pas été l'œuvre de quelques fanatiques obéissant à un illuminé charismatique, mais une opération méthodique supposant le fonctionnement sans faille de multiples structures d'obéissance dont les victimes elles-mêmes n'ont pas été exemptes en se pliant par exemple au port de l'étoile jaune.
En fait l'obéissance n'est pas un comportement individuel, mais se révèle être dans la plupart des cas un comportement mimétique. Il est difficile de désobéir lorsque tout le monde obéit, tout de même qu'à l'inverse, il est difficile d'obéir lorsque tout le monde désobéit. Au théâtre, autrefois, (est-ce ce vrai encore aujourd'hui ?) Il suffisait de payer quelques complices surnommés « la claque », chargés d'applaudir au bon moment pour que toute la salle obtempère et applaudisse sans hésitation.
L'obéissance serait donc avant tout liée aux facultés mimétiques de l'être humain : idée développée par Isabelle Samyn dans un article de cerveau et psycho n° 8 -décembre 2004/février 2005 - obéissance et imitation. Dans cet article l'auteur avance la thèse suivant laquelle le degré d'obéissance serait directement lié aux facultés d'imitation de l'individu. Certains ainsi seraient plus obéissants que d'autres. Isabelle Samyn voit dans cette différence une plus ou moins grande faculté à identifier les intentions d'autrui et du même coup à analyser ses propres intentions.
Se dessine ainsi implicitement une véritable pédagogie de l'obéissance, totalement distincte de l'apprentissage de la soumission au pouvoir : apprendre à obéir serait d'abord apprendre à imiter.
Éthiquement est-ce préférable ? Pour le bon fonctionnement des institutions certainement ! Pour le reste, le grégarisme de l'obéissance et le caractère aveugle de l'acceptation de l'autorité peuvent mener à cette absurdité de certains comportements collectifs que soulignait déjà Étienne de La Boétie : « Pour ce coup, je ne voudrais sinon entendre comme il se peut faire que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qu'ils lui donnent ; qui n'a pouvoir de leur nuire, sinon qu'ils ont pouvoir de l'endurer; qui ne saurait leur faire mal aucun, sinon lorsqu'ils aiment mieux le souffrir que lui contredire. [...] Si deux, si trois, si quatre ne se défendent d'un, cela est étrange, mais toutefois possible ; bien pourra l'on dire, à bon droit, que c'est faute de cœur. Mais si cent, si mille endurent d'un seul, ne dira l'on pas qu'ils ne veulent point, non qu'ils n'osent se prendre à lui, et que c'est non couardise, mais plutôt mépris ou dédain ? Si l'on voit, non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille ville, un million d'hommes, n'assaillir pas un seul, duquel le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serf et esclave, comment pourrons-nous nommer cela ? Est-ce lâcheté ? Or, il y a en tous vices naturellement quelque borne, outre laquelle ils ne peuvent passer : deux peuvent craindre un, et possible dix ; mais mille, mais un million, mais mille villes, si elles ne se défendent d'un, cela n'est pas couardise, elle ne va point jusque là ; non plus que la vaillance ne s'étend pas qu'un seul échelle une forteresse, qu'il assaille une armée, qu'il conquête une armée. Donc quel monstre de vice est ceci qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve point de nom assez vilain, que la nature désavoue avoir fait et la langue refuse de nommer ? [...]
Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon que l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux, dont il vous épie, si vous ne les lui baillez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous ? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont des vôtres ? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous, que par vous ? Comment vous oserait-il courir sus, s'il n'avait intelligence avec vous ? Que vous pourrait-il faire, si vous n'étiez receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue et traîtres à vous-mêmes ? [...] Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. » Discours de la servitude volontaire, 1546-1555, pp. 132-139.
Alors, pour conclure ce propos : l'obéissance est-elle un moyen terme ou une étape entre la soumission et l'autonomie ? Oui, si cette obéissance est autre chose que l'acceptation aveuglée et aliénée d'une autorité quelle qu'elle soit ; oui, si cette obéissance est autre chose que l'expression d'un grégarisme bêtifiant.
Parents, pédagogues, thérapeutes, animateurs des institutions les plus diverses, si notre bonne conscience nous interdit bien souvent d'exiger la soumission de ceux dont nous avons la charge, nous en attendons souvent l'obéissance sans toujours bien cerner les perversions possibles d'un tel comportement.
Ceux dont nous sommes pour un temps éducateurs ou responsables devront un jour pour être autonomes briser les chaînes de la soumission et l'aliénation de l'obéissance.
Eric Douchin
_______________________________